Le papier
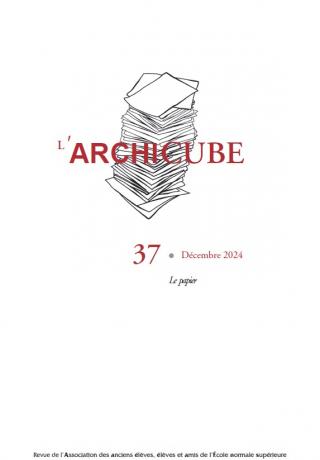
L'archicube n°37 -
25-12-2024
Le papier
Éditorial
Présentation du thème
Sommaire
Les normaliens publient
L'ARCHICUBE N°37 : LE PAPIER : SOMMAIRE
Fabriquer, conserver, recycler
- De quoi le papier est-il fait ? Pierre-Marc de Biasi
- Le papyrus, Guy Lecuyot
- O papel da Amazônia, Hervé Théry
- Papier ou numérique : un cas pratique en matière de développement durable, Jean Le Moux
- Papier et environnement : un cas exemplaire d’économie circulaire, Jean Le Moux
- Le papier hygiénique, Wladimir Mercouroff
Mémoire du papier …
- Quelques rappels utiles sur le papier et l’imprimé, Pierre Barki
- Du papier pour l’Histoire, Nicolas Mercouroff
- Archives diplomatiques, Jean Mendelson
- Madame de Sévigné et les précieuses leçons du papier des autographes, Mireille Kervern-Gérard
- Proust dans son labyrinthe, Francine Goujon
- Apprendre des autres, diffuser les combats d’une vie, Claire Monteil
- L’enveloppe postale, Wladimir Mercouroff
- Compte rendu de la journée d’étude « Actualité de la recherche en histoire du papier », Jean-Sébastien Macke
- Du papier et des livres, Lucie Marignac
In paper we trust
- Les grands papiers, une espèce en voie de disparition, Stéphane Téboul
- Le paradoxe de la monnaie de papier, Arnaud Manas
- Le papier de la monnaie, Arnaud Manas
- Vos papiers ! Ou les contrôles d’identité en examen, Jacques de Maillard
Utile et créatif…
- À partir d’une feuille, Tadashi Tokieda
- Le format A4, Martin Andler
- Le papier dans la culture japonaise, Claire Akiko-Brisset
- Tailler la couleur : les papiers découpés de Matisse, David Brunat
- Le collage dans l’œuvre d’Hannah Höch, Catherine Frèrejean
- Cinéastes, vos papiers ! Jean-Michel Frodon
- Dans la mode, le papier utilisé comme une fibre textile, Lucas Delattre
- Affiches et service public, Marc Chaperon
- Les affiches, Wladimir Mercouroff
L'ARCHICUBE N°37 : LES NORMALIENS PUBLIENT
LIBERTÉS URBAINES
Recension de l’ouvrage de Patrick Boucheron, Paris, CNRS Éditions, « Les grandes voix de la recherche », 2024, 96 pages.
Cet essai court et dense de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, retrace l’itinéraire qui a conduit celui-ci à étudier l’histoire des villes, « histoire du bâti » mais aussi « histoire de la mémoire », avec comme point de départ l’Italie médiévale et les rapports entre « formes urbaines d’une métropole et formes politiques du pouvoir princier ». Il montre comment la ville, notamment (mais pas seulement) en tant que lieu d’asile et d’affranchissement pour les serfs fugitifs, comme Bologne spectaculairement en 1257, et jusque dans son lacis compliqué qui s’oppose à l’aménagement officiel des places, a pu être – et peut être encore – « le trouble-fête d’une histoire souveraine » et un espace de liberté. La ville médiévale ne se développe pas contre l’ordre féodal mais en accord pacifié avec lui. Cependant, cette expérience se heurte au double écueil de la durabilité et de la scalabilité » (passage à une échelle plus grande) : « Est-ce que les règles de représentation électorale, de délibération commune et de collégialité de la décision politique, qui valent pour des corps urbains comme ceux de Florence, Bologne ou Venise, forts de dizaines de milliers d’habitants, sont applicables à plus grande échelle ? ». L’histoire des villes italiennes a illustré le bien-fondé de ce doute. Le risque d’une perte des valeurs civiques et d’une reprise en mains par la seigneurie est notamment illustré à Sienne dans la fresque dite du « bon gouvernement » d’Ambrogio Lorenzeti (que Boucheron avait analysée magistralement dans Conjurer la peur).
Patrick Boucheron oppose l’espace public monumental, organisé, officialisé, solennel, tel qu’il est défini en 1452 dans le De re aedificatoria d’Alberti, à l’espace public individualisé et libre des maisons et des rues où le mouvement n’est pas prescrit ou ordonné. À partir du socle de l’histoire de villes médiévales, l’auteur s’interroge sur les espaces de liberté dans les villes d’aujourd’hui, car « si on est historien, c’est d’abord, je pense, parce qu’on demeure indéfectiblement, malgré toutes les angoisses sur l’avenir, amoureux du présent ».
La lecture de cet essai suscite une triple envie : lire ou relire les autres ouvrages de Boucheron (je me suis mis à les lire après avoir découvert sa splendide leçon inaugurale au Collège de France Ce que peut l’histoire), découvrir les nombreux ouvrages qui l’ont marqué (y compris un roman de science-fiction, Les Furtifs d’Alain Damasio), enfin, forts de ces interrogations, déambuler en « pensant depuis le Moyen Âge » dans les rues d’une ville. Citons encore notre auteur : « Pour moi, l’amour des villes est jumeau de l’amour des livres et je n’aime rien tant que me promener dans les unes ou feuilleter les autres. ».
Stéphane Gompertz (1967 l)
SOUVENIRS D’UN HARENG SAUR
Recension de l’ouvrage de Jean Ehrard, lulu.com, 2019, 570 pages.
Le titre de l’ouvrage est emprunté à une fausse citation de Victor Hugo : « Il sortit de la vie comme un vieillard en sort ». Jean Ehrard (1955 l) y retrouve un souvenir d’enfance : son père, garagiste, livrait aussi de la nourriture en Bourgogne. Jean Ehrard contemplait émerveillé « les teintes mordorées, luxueuses, des harengs qu’il disposait sur des claies dans sa camionnette ». L’autre origine de la contrepèterie est l’âge du rédacteur. C’est le 12 novembre 2009 que Jean Ehrard décide d’écrire ses souvenirs : il a 83 ans, l’aîné de ses petits-fils en a 18, et le grand-père ne peut qu’admirer rétrospectivement l’éclat des harengs saurs. L’image est reprise à la fin du témoignage : Jean Ehrard y évoque « une passion de vivre née dans la fascination d’un Hareng saur dont la beauté a émerveillé ma petite enfance. » Ce procédé de rappel est repris à plus grande échelle dans le livre. En effet, les quatre cents premières pages sont rédigées par Jean Ehrard, puis, en 2015, il devient brusquement aveugle. Il décide alors de s’adresser à son amie Claudine Cohen, membre de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) qui souhaite mieux connaître sa formation intellectuelle. Elle l’enregistre et il ne conserve que ce qui ne fait pas double emploi. Après le témoignage écrit de l’auteur, on peut donc lire une centaine de pages qui reprennent un enregistrement de sa voix.
On sait que Jean Ehrard est le grand spécialiste de Montesquieu, auquel il a consacré sa thèse intitulée L’Idée de nature en France dans la seconde moitié du xviiie siècle (SEVPEN, 1963). Ce travail est l’aboutissement d’une longue démarche qui l’a promu professeur à l’Université de Clermont-Ferrand. Mais cette promotion intervient après un long parcours : issu de milieu modeste, Jean Ehrard est un bel exemple d’ascension sociale grâce à l’école. Son père, habile mécanicien, passé de la voiture à l’avion, a été gazé pendant la première guerre mondiale. Il exerce un métier plus facile au service des douanes, ce qui l’oblige à s’exiler à Sarrebruck et à Forbach, avant d’obtenir une mutation pour Nice. Sa mère, orpheline très jeune, vivait dans un milieu pauvre ; elle a été adoptée par la famille protestante de son mari. Le père de Jean Ehrard est un socialiste convaincu. 1936 est une grande date, avec les congés payés que Jean voit sur les routes de Nice. Il va jusqu’à se battre avec un camarade, fils de pharmacien, qui insulte Léon Blum. C’est en 1942, pendant le procès de Riom. « Je reste fier de ma réaction de ce jour-là », dit-il à Claudine Cohen.
Avec la libération, les services des douanes émigrent. La famille Ehrard pourrait avoir un grand appartement dans le Jura. Mais les études du fils requièrent une installation à Paris. Boursier, Ehrard intègre le lycée Louis-le-Grand, dont le proviseur reçoit son élève avec condescendance : il se présentera au concours général, mais au titre de son établissement niçois. Jean Ehrard aura un accessit au concours général. Le voilà en hypokhâgne à la rentrée 1943. Il y suit les cours du latiniste Sausy, de l’helléniste Séchan et, en khâgne, de Roger Pons. C’est Pons qui lui fait connaître Lucien Fèbvre : dans un débat avec Abel Lefranc à propos de Rabelais, il récuse l’idée que Rabelais soit un précurseur du rationalisme athée. « N’importe quoi ne peut être pensé n’importe quand ». C’est une véritable illumination : « Sans que je l’aie su immédiatement, c’est ce jour-là que j’ai trouvé ma voie. » (Souvenirs d’un Hareng saur, p. 140) Reçu à l’École en 1946, il a pour ami Marcel Roncayolo, qui l’invite chez lui à Marseille. Roncayolo sera plus tard directeur adjoint de l’ENS (de 1978 à 1988) où il créera la section S devenue B/L avec mathématiques et sciences sociales. Son meilleur professeur à Nice était Sylvain Broussaudier, normalien de la promotion 1924, muté de Nice à Cahors pour avoir refusé d’accepter dans sa classe, en 1941, le portrait du maréchal Pétain avec la formule : « Pas de ça chez moi ».
L’illumination à l’origine de sa thèse a lieu dans les Vosges, où il fait une randonnée de Saint-Dié à Colmar : au col de la Schlucht, il s’écrie devant Roncayolo : « Il me faut des disciples ! » car il n’envisage pas de travailleur seul sur l’idée de nature. Son mémoire de maîtrise est dirigé par Maurice Levaillant, et porte sur « L’idée de nature dans L’Esprit des lois ». Agrégé de lettres classiques, Jean Ehrard voudrait retrouver Nice ; mais le président du jury d’agrégation, Morisset, lui explique que c’est impossible. Il est nommé à Ajaccio. Il y passe une année avant d’être nommé à Sens, bien plus près de Paris. Il se réserve une journée à la Bibliothèque nationale, où il rencontre son camarade de promotion Robert Mauzi, qui travaille à sa thèse sur l’idée de bonheur au xviiie siècle. En 1955, son maître Pintard lui propose de diriger un « diplôme », comme on disait à l’époque, portant sur Diderot. Le sujet est Le Paradoxe du comédien lu par les comédiens d’aujourd’hui. La candidate, Antoinette Blachère, sera la femme du professeur. René Pintard dirige scrupuleusement le travail de Jean Ehrard, en respectant sa liberté de chercheur. Il lui suggère de suivre le séminaire d’Alexandre Koyré sur Newton et d’assister aux cours de Lucien Fèvre, auquel le présente Palmade, caïman d’histoire à l’École. Fèbvre lui propose un article à paraître dans les Annales ESC (économies, sociétés, civilisations). Ce sera la première publication scientifique d’Ehrard, en 1958.
Ses amis de l’École, Guy Palmade, Marcel Roncayolo, Louis Bergeron, lui conseillent de suivre les cours d’Ernest Labrousse, professeur d’histoire économique à la Sorbonne. Ehrard y acquiert une compétence technique en étudiant les salaires, les profits, les idées de Physiocrates. Il retrouve son camarade de promotion Jacques Morel, devenu caïman de français, et fait la connaissance du stendhalien Michel Crouzet. Mais, à cette époque, on ne peut être assistant que quatre ans et, en 1957, Jean Ehrard retrouve le secondaire, avec un poste au lycée Voltaire. Il y passera deux années. Grâce à l’appui de Pierre Moreau, qui lui demande un État présent des études sur Montesquieu, et à son directeur de thèse complémentaire Jean Fabre, il obtient un détachement au CNRS qui lui permettra de terminer sa thèse. Marié depuis 1957, Ehrard entreprend avec sa femme et sa fille un voyage d’études en Italie, pour voir les œuvres italiennes dont parle Montesquieu. Désormais titulaire d’une thèse, Jean Ehrard hésite entre diverses possibilités, mais trouve finalement un poste de maître de conférences à Clermont-Ferrand, où il retrouvera ses camarades de promotion Michel Foucault et Paul Viallaneix. Il se lie avec Raynaud de Lage, médiéviste célèbre et militant syndical, plus âgé que lui. La thèse principale achevée, il faut la faire imprimer, et les 900 pages dactylographiées le sont grâce à l’intervention de Fernand Braudel, qui l’insère dans la Bibliothèque de la sixième section de l’École pratique des hautes études (EPHE). Le jury est constitué par Pintard, directeur de thèse, Pomeau, devenu un ami, et Paul Vernière. Ehrard obtient la mention très honorable à l’unanimité.
Le choix de Montesquieu s’explique par d’apparentes contradictions : dès l’époque de son mémoire, Ehrard s’est interrogé sur « un chapitre du livre XV (de L’Esprit des lois) où l’esclavage est curieusement déclaré comme à la fois naturel et contre-nature » (Souvenirs d’un Hareng saur, p. 184). Ehrard se demande comment c’est possible. Il précise sa pensée dans son entretien avec Claudine Cohen : au début du livre XV de L’Esprit des lois, « l’esclavage des nègres est à la fois condamné comme contraire à la Nature, et rendu inévitable, dans certains climats, par des raisons naturelles » (Souvenirs d’un Hareng saur, p. 433) L’auteur y revient encore dans un passage plus précis, qui évoque la visite des mines du Harz par Montesquieu : « Le chapitre 8 du livre XV note : « On peut par la commodité des machines que l’art invente ou applique, suppléer au travail forcé qu’ailleurs on fait faire aux esclaves ». S’il y a des esclaves, ce n’est pas parce que certains hommes sont « paresseux » mais parce que les lois sont mal faites.
Cette ambivalence fait l’attrait de la diversité. Ehrard la retrouve dans sa propre existence : né en Bourgogne, il s’attache à Nice et à son arrière-pays, non loin du Mercantour, où il a passé sa jeunesse. Il aime Paris, mais aussi l’Auvergne et la ville de Riom, sa seconde patrie, dont il est maire socialiste pendant douze ans. C’est moins un enracinement qu’une inscription, par l’étude de compatriotes remarquables, comme Gilbert Romme, « le dernier des Montagnards » selon Albert Soboul, grand homme de Riom, tué sous la Révolution après l’échec de la journée du 1er Prairial an III (20 mai 1795) par laquelle les Montagnards demandaient un maximum pour le prix du pain et le rétablissement de la Constitution montagnarde. C’est par là que se termine le livre. Il faudrait développer davantage les engagements syndicaux et politiques de Jean Ehrard. C’est lui qui réclame plus de transparence dans la gestion de la municipalité, ce qui lui vaut d’être élu maire. Très attaché aux échanges entre chercheurs de diverses nationalités, il coopère notamment avec son ami Shakleton, avec qui il travaille à la publication des Œuvres complètes de Montesquieu, publiées à Oxford par la Voltaire Foundation et à Paris par les Classiques Garnier à partir de 1998.
En 2015, Jean Ehrard devient brusquement aveugle. Mais il garde une curiosité universelle et continue de s’intéresser à une vie qu’il veut à la fois intime, politique et littéraire. C’est sur cette unité que nous souhaitons conclure : évoquant le bicentenaire de la Révolution en 1989 et celui de la République en 1992, il déclare : « Je conserve une grande tendresse pour ces moments exceptionnels où mes activités de chercheur et de citoyen se sont superposées, rejointes, confondues. »
Jean Hartweg (1966 l)
HISTOIRE ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE : DE LA GAULE À NOS JOURS
Recension de l’ouvrage de Charles Serfaty, Paris, Passés / Composés, 2024, 528 pages.
Charles Serfaty, ancien élève de la rue d’Ulm (promotion BL 2011), est docteur en économie du MIT, économiste à la Banque de France et enseignant à l’École d’économie de Paris. Il réécrit l’histoire de France en analysant la situation économique du pays.
Ainsi la Gaule de Vercingétorix était un pays agricole dont le niveau de vie était comparable à celui des Romains ; les Gaulois qui se disaient « Celtes » avaient beaucoup défriché, utilisaient des charrues, chaulaient les sols ; ils cultivaient du blé et faisaient du vin. La domination romaine a profité à la Gaule, par ses routes militaires et son « marché commun » méditerranéen avec le port de Massalia, création grecque, futur Marseille. La Gaule profitait de sa position avantageuse entre façade maritime atlantique et nordique et la Méditerranée.
Mais, à partir du iie siècle et jusqu’à l’avènement de Charlemagne, la peste Antonine et les invasions barbares, Huns à l’Est, Viking-Normands venant du Nord, provoquent la mort lente de l’Empire romain.
Le Moyen-Âge est une époque de croissance ; le développement des moulins supplée le travail du meunier, aidant à la disparition de l’esclavage, remplacé par le servage. À partir du xiie siècle, l’apparition du papier bon marché, qui a remplacé le parchemin, permet le développement des bibliothèques et l’édification d’un État de droit, en fixant par écrit un droit seigneurial variant selon les caprices du suzerain, ou un droit coutumier fluctuant.
Dans une France unifiée par Clovis et ses descendants, les foires prospèrent dans un pays défriché. Les seigneurs et les abbayes infligent des impôts féodaux, mais la guerre fait naître un impôt royal.
Aux xve et xvie siècles, l’Europe devient riche, mais la France rate l’Amérique. L’imprimerie se développe sur la soif de lecture, mais son impact économique est limité, car le livre reste un produit cher, réservé aux riches, même si son prix est divisé par dix. La Réforme crée des troubles civils qui contribuent à la naissance d’une dette royale, aggravée par la guerre et la Fronde, malgré les effort de Sully et de Colbert.
La fin du xviie siècle voit la modernité des Lumières, mais la réforme ratée des finances avec John Law, et l’essor du commerce extérieur. L’Empire est marqué par une crise de la dette souveraine.
Le siècle qui suit voit un développement des infrastructures, notamment du chemin de fer, et un début d’industrialisation dans un pays de paysans et d’une agriculture à l’abri des droits de douanes. La IIIe République apporte la promesse de l’École pour tous à la fin du xixe siècle.
Le xxe siècle est marqué dès son début par une guerre de trente années (1914-1918 et 1939-1945). L’économie se relève grâce au « Plan Marshall » et donne naissance aux « Trente Glorieuses ». Mais, en 1970, elles sont remises en cause par un « choc pétrolier » et aujourd’hui, enfin, par le poids de la dette et celui du changement climatique.
Wladimir Mercouroff (1954 s)
UNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : 1870-1940
Recension de l’ouvrage de Jean-Noël Jeanneney, Paris, Bouquins, 2024, 1344 pages.
On ne présente pas Jean-Noël Jeanneney, normalien littéraire de la promotion 1961, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques, deux fois secrétaire d’État, président de la mission du bicentenaire de la Révolution de 1789, président de la Bibliothèque nationale, fondateur de l’émission « Concordance des temps » et auteur de nombreux ouvrages historiques, dont un Clemenceau.
Une carrière universitaire
Son dernier ouvrage, Une République française, récuse les visions trop simples du roman national : Clemenceau tombeur de ministères et père de la patrie, Jaurès pacifiste tué à l’arrivée de la guerre de 14, François de Wendel représentant patenté des « deux cents familles ». Jeanneney est adepte d’une histoire reposant sur des enquêtes minutieuses : aux pages 709 à 741, il reprend son mémoire de « diplôme d’études supérieures, comme on appelait à l’époque la maîtrise, dirigé par Pierre Renouvin et intitulé « Recherches sur le moral de l’armée française au printemps 1917 d’après la correspondance des combattants ». « Première publication scientifique » de l’aveu même de l’auteur, ce travail met l’accent sur les conditions du recueil des témoignages : collecte des données, mode de lecture, grille utilisée par les censeurs, distinction entre « temps bref » (la période des mutineries) et « comportement stable » sur la durée du conflit. De grandes lignes se dessinent : détestation de l’ennemi héréditaire, nationalisme terrien et paysan.
Plus tard, intéressé par les rapports entre argent et pouvoir, Jeanneney consacre sa thèse de doctorat à François de Wendel. L’article « François de Wendel et les siens » (p. 331-311) reprend la conclusion de sa thèse. Conclusion nuancée, car si le statut social de François de Wendel est solide, avec la présidence du Comité des Forges, le poste de régent à la Banque de France, la possession du Journal des Débats, la députation de Meurthe-et-Moselle, ses résultats varient selon les domaines : il joue un rôle important dans la politique intérieure, étant notamment l’artisan de l’échec du Cartel des Gauches et du retour de Poincaré au pouvoir, son « chef-d’œuvre », en 1926. En politique étrangère, de Wendel, nationaliste, est conscient de la nécessité d’une politique suivie à l’égard de l’Allemagne. « Je dis que quand il s’agit d’un fait comme la politique de rapprochement franco-allemand, ou il faut la vouloir, ou il faut l’écarter. C’est un cas où on n’a pas le droit d’avoir des vues en zigzags », déclare-t-il en 1927 à la Commission des affaires étrangères. Mais on le sait : après l’occupation de la Rhénanie en 1922, la France laissera Hitler remilitariser la région en mars 1936. Finalement, Jeanneney conclut que « son histoire confirme avec éclat l’autonomie du secteur politique par rapport aux forces économiques et financières ».
Composition du livre
La composition quasi musicale de l’ouvrage ménage une autre approche. L’ouverture présente trois « Phares », avec pour précurseur génial Victor Hugo : Jean-Jaurès, Clemenceau, Georges Mandel. Ensuite, parmi des « Figures » nombreuses, se détachent René Rémond, « l’historien dans l’action », Waldeck-Rousseau, « l’homme qui sauva la République » Jules Jeanneney, président du Sénat et grand-père de l’auteur, et surtout Léon Blum, grande figure inspirée par Clemenceau. Le développement intitulé « Passions et douleurs » commence par une remarquable étude sur le duel, qui oppose les mœurs à la légalité républicaine. Il se poursuit avec des réflexions sur la guerre, qui a mis fin aux duels aristocratiques. Les « Histoires d’argent », quatrième rubrique, prolongent la réflexion engagée dans la thèse sur de Wendel. La section V, Signes et média, faite de textes plus courts, reprend aussi la thèse, avec des articles sur Étienne de Nalèche, directeur du Journal des Débats, et un Haro sur les deux-cents familles. Le chapitre intitulé Interventions, combats est dominé par une analyse de la faillite du Cartel des gauches. Le bouquet final est un texte lu et joué plusieurs fois de 2011 à 2023, inspiré par la captivité de Léon Blum et Georges Mandel en marge du camp de Buchenwald.
L’ouverture est dominée par la figure de Clemenceau. L’auteur tient à le disculper des préjugés simplistes. Le « tombeur de ministères » est d’abord celui qui, le 30 mars 1885, accuse Jules Ferry et ses ministres, en difficulté au Tonkin, de « haute trahison », car leur colonisation contraire aux idéaux de 1789 détourne la France du seul combat qui compte : la revanche sur l’Allemagne qui a colonisé Alsace et Lorraine. Clemenceau, on le sait, n’a jamais admis l’argument de Ferry selon lequel les « civilisations supérieures » avaient le devoir de former les colonisés. L’autre aspect bien connu de Clemenceau est sa passion du duel : il a pris part, dès 1871, à douze rencontres, dont, en 1894, un duel avec Deschanel, le futur président, qui fait preuve d’une insigne lâcheté. Selon Jeanneney, Clemenceau est, par son sang-froid, son courage et son habileté aux armes, la « figure emblématique » du duel. Une longue étude montre que la justice ferme les yeux sur la plupart des duels, car ils permettent de sanctionner sans scandale des manquements à l’honneur qui ne sauraient se traiter au tribunal. Jeanneney défend Clemenceau dans tous les domaines, y compris contre ceux qui l’accusent d’avoir brisé des grèves insurrectionnelles entre 1906 et 1909, quand il était à la tête du gouvernement.
Léon Blum et Georges Mandel
Les figures de la Troisième République sont trop nombreuses pour être toutes évoquées ici. Mais deux noms méritent d’être mentionnés, d’autant qu’ils se sont retrouvés en 1944 dans une captivité commune, aux abords du camp de concentration de Buchenwald : Léon Blum et Georges Mandel. Léon Blum peut paraître, à la lumière de sa direction du Front populaire, comme un disciple de Jaurès. Détenu de 1940 à 1943 au château de Bourassol, près de Riom, il y a écrit À l’échelle humaine, réflexions sur la défaite et sur l’avenir. Il s’y montre favorable à un pouvoir exécutif fort, de type présidentiel. Mais à partir de 1945 il change : il souhaite une assemblée toute-puissante, ce que lui reprochent des analystes aussi réputés que Raymond Aron. Sans doute faut-il y reconnaître une méfiance, alimentée par le souvenir du coup d’État du 2 décembre 1851, envers le général de Gaulle. Georges Mandel est un personnage moins brillant, mais très fidèle à Clemenceau, dont il connaît les discours quasiment par cœur. Mais Clemenceau ne veut à aucun prix que Mandel apparaisse comme son inspirateur. Juif, Mandel s’appelle Louis Rothschild de son nom de naissance, sans aucun rapport de parenté avec le banquier. Son père est tailleur. Comme toute sa communauté, il est frappé par l’affaire Dreyfus, qui ruine la confiance que les Juifs accordaient à la France révolutionnaire. Clemenceau n’est nullement antisémite ; mais il ne s’interdit pas les moqueries de mise à l’époque et Mandel en souffre. Quand, très hostile aux accords de Munich, il les condamne, on lui reproche de s’opposer à l’Allemagne de Hitler en tant que Juif. Par compensation, il s’invente normalien et s’attribue deux frères tués à la guerre. Il n’en devient pas moins président du conseil général de Gironde. Il passe la fin de sa vie, de mai 1943 à juillet 1944, à Buchenwald. Mais, enlevé par les SS, il finit assassiné par la milice.
Coda
Nulle part n’apparait plus nettement la grandeur de Clemenceau et sa vocation universaliste que dans l’image de la marche vers ce qui sera la tombe du soldat inconnu inaugurée en 1920. Clemenceau donne la main à deux enfants, la nièce d’André Tardieu et le père de Jean-Noël Jeanneney, futur juriste. C’est le passé associé à l’avenir, ainsi que l’évoque non sans emphase le général Mordacq : « C’était l’ancienne France qui, après avoir arrêté les maudits, s’avançait la main dans la main, étroitement unie avec la France nouvelle, celle qui allait profiter de la victoire pour adresser à ceux qui avaient cimenté cette victoire de leur sang, aux glorieux morts, un remerciement solennel. »
J. H.



