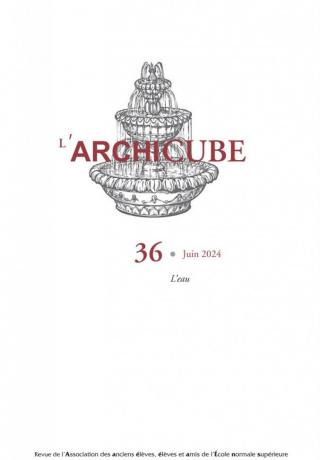L'eau
SOMMAIRE
Éditorial
LE DOSSIER : L’EAU
L’eau dans l’univers
H2O, l’une des plus importantes molécules cosmiques, Alain Omont
L’eau, Olivier Tillement
L’eau et la vie, André Brack
La longueur des fleuves, Wladimir Mercouroff
Le cycle de l’eau et le changement climatique, Marie-Antoinette Mélières
L’eau et les sociétés humaines
L’eau en Égypte, Guy Lecuyot
L’eau dans la ville romaine : Pompéi, un cas hors norme, Hélène Dessales
Le signal du sourcier, Wladimir Mercouroff
Face aux épidémies : du bon usage des eaux usées, Antoine Danchin
Captage, production et distribution de l’eau potable en Île-de-France :
l’exemple d’AQUAVESC, Stéphane Gompertz
La Cour des comptes au fil de l’eau : 50 ans de rapports dans les remous
des politiques publiques, Danièle Lamarque
Vivre ensemble avec l’eau en France, un enjeu d’éducation et de sens
du collectif, Gérard Payen
Natation et physique, Amandine Aftalion
Jean Prévost se jette à l’eau, Emmanuel Bluteau
L’eau et le sport, David Brunat 77
Penser et rêver l’eau
Euler et les fontaines de Sans-Souci, Yann Brenier
Gaston Bachelard : L’Eau et les Rêves, Jean Hartweg
Thalassopoétique, Isabelle de Vendeuvre
L'ARCHICUBE N°36 : LES NORMALIENS PUBLIENT
DU COSMOS À LA VIE
Dans ce nouvel opus, notre camarade Jean Audouze s’est associé à une biologiste, Marie-Claude Maurel, spécialiste de l’apparition de la vie sur Terre, pour nous entraîner dans un vaste voyage. Une aventure à la fois lointaine, qui débute avec le Big Bang, et proche, pénétrant les mécanismes intimes du vivant. Une histoire des origines, qui nous trans- porte de l’immensité de l’Univers à l’intimité biochimique de nos cellules, de l’infini à l’espèce humaine.Les auteurs nous rappellent combien la structure de l’Univers est fondamentalement « simple », puisque « atomique », ou « nucléaire», c’est-à-dire descriptible en termes de particules élémentaires, elles-mêmes soumises à quatre types d’interactions (faibles, fortes, électromagnétiques, gravitationnelles) dont les vecteurs sont à leur tour des « particules », photons pour l’électromagné- tisme, gluons pour la gravité, bosons pour les deux autres. Ce rappel de la structure de l’Univers est nécessaire pour en comprendre toute l’histoire, déroulée au fil des pages et qui converge, du point de vue terrien, à la vie sur Terre.
Si tout débute avec ce Big Bang, il y a 13,7 milliards d’années, une datation dont cet ouvrage permet de mieux comprendre les fondements, les évènements qui suivent nous sont ici décrits avec précision et de cette façon accessible dont Jean Audouze est familier. La question récurrente de « l’avant Big Bang » et des « métavers » n’est pas éludée. Des notions essentielles comme le « Mur de Planck », qui nous interdit de concevoir les 10-43 secondes qui ont suivi cette explosion originelle, mais marque les débuts de la naissance de l’Univers à la physique, sont rendues compréhensibles. C’est 300 000 ans plus tard, après une phase opaque où les photons ne peuvent s’échapper de la « soupe » initiale, qu’il devient « transparent » et que la « lumière fut ». Commence alors cette fameuse expansion qui n’a dès lors plus cessé. Ce tourbillon de créations, où l’énergie immense disponible autorise interactions et accrétions, donne naissance à des condensations en amas de matière. L’ère stellaire résultante, immense ballet cosmique, voit la formation des galaxies et des étoiles, dont la nôtre, le Soleil. La chorégraphie est précise. Une précision qui n’exclut pas les rencontres aléatoires. Et voit notamment l’émergence du Système solaire avec ses huit planètes dont notre Terre, planète singulière, idéalement située par rapport à son astre, qui a enfanté une lune, est devenue « bleue », car couverte d’océans, selon un enchaînement d’évènements créateurs que les auteurs nous décrivent avec passion. Peu importe que cette eau ou que des molécules primaires aient été en partie ou en totalité apportées ou créées sur place. Le processus formateur est ici clairement démonté. Avec l’eau, ce sont les éléments fondamentaux qui vont pouvoir naître et s’orga- niser dans ce qui sera la vie. Une émergence jaillie du bouillon originel, il y a moins de quatre milliards d’années, mobilisant carbone et hydrogène, éléments simples fondamentaux. Des molécules plus complexes émergeront du bombardement initial et s’organiseront, par des interactions chimiques claires, en des structures primitives de plus en plus complexes, sans doute adsorbées sur des surfaces minérales. Dans une première période, ces ébauches cellulaires tireront leur énergie de réactions produisant du gaz carbonique. Lui succède une deuxième période, décisive, où les organismes primitifs produiront de l’oxygène en mobilisant l’énergie des photons solaires, ébauche de photosynthèse. L’atmosphère actuelle se crée, rendant la vie, sous sa forme nouvelle, aérobie, plus efficace. Tout va alors s’enchaîner, la complexité engendrant de la complexité. Des systèmes vivants vont en créer sans cesse de nouveaux, évoluant vers une grande variété. Libérés de la contrainte aquatique, ils s’installent en milieu terrestre. Ils investissent tous les milieux disponibles. Ils conservent, dans une sorte d’économie de moyens, ce qui fonctionne bien et perfec- tionnent sans cesse le reste : le gène qui initie la construction d’un œil est semblable pour la mouche, le ver, l’homme, la souris, la grenouille.
Cette évolution n’est cependant pas linéaire et ne va pas sans accidents majeurs, subissant de grandes extinctions de masse. Elle s’en relève à chaque fois, en puisant dans les réservoirs génétiques disponibles. Ainsi la cinquième grande extinction, il y a 66 millions d’années, a vu la disparition des dinosaures (excepté les aviaires), mais ils furent remplacés par les mammifères. Et parmi ceux-ci a surgi peu à peu un animal très particulier (à nos yeux) : l’humain, au sein de la famille, vieille de 15 millions d’années, des Hominidae. Spécialisés dans la station bipède il y a 7 millions d’années environ, nos ancêtres ont évolué en des formes diverses, devenant Homo habilis, puis erectus, et enfin sapiens avec sa variante fraternelle néandertalienne. L’ouvrage retrace ces étapes d’une espèce voyageuse, métissée, intimement dépendante de la
biodiversité qui l’entoure. Le paradoxe est qu’elle est engagée dans sa destruction, initiant une sixième extinction, massive et rapide, trop rapide sans doute pour que sa conséquence ne soit pas tragique.
François Bouvier (1961 s)
L’ ÉPÉE JETÉE AU LAC. ROMANS DE LA TABLE RONDE ET LÉGENDES SUR LES NARTES
Recension de l’ouvrage de Joël-Henri Grisward, Paris, Honoré Champion, 2022, 194 pages.
Ce livre, qui se lit malgré son érudition comme une enquête policière, prolonge d’autres ouvrages de l’auteur consa-
crés à la littérature du Moyen Âge, notamment Archéologie de l’ épopée médiévale (1981). Il est surtout le résultat d’une révéla- tion : fervent élève et lecteur de Dumézil, Joël-Henri Grisward a été frappé par ce passage du maître sur un héros caucasien :
« À la fin, il clame son secret : la mort ne le prendra que lorsque sa puissante épée sera jetée dans les eaux de la mer Noire. » Or c’est exactement ainsi que meurt le roi Arthur, celui de la Table Ronde, dans La Mort le roi Artu (roman en prose du
xiiie siècle). C’est ainsi que démarre l’enquête, qui nous mène à d’autres personnages, à d’autres motifs, et surtout à un tissu de relations à la fois entre les personnages et entre les cultures.
L’intérêt du livre tient d’abord à ce rapprochement entre notre monde médiéval et ce peuple mystérieux des Nartes, héros fabuleux de ces Scythes dont nous parle Hérodote et « qui, lors des grandes invasions, circulèrent à travers toute l’Europe, et jusqu’en France, sous le nom d’Alains », ancêtres des Ossètes1. À la suite de l’auteur, nous oscillons tout au long du livre entre monde arthurien et monde ossète. Mais, méthode comparative oblige, Grisward convoque aussi, à l’occasion, les légendes et la littérature germaniques, scandinave, celtique, notamment lorsqu’il rapproche Arthur le guerrier (la fonction royale ne viendra que plus tard) et le héros irlandais Cuchulainn. Et, nous le verrons, tout converge.
Le livre est centré autour de trois personnages, ou plutôt trois paires de person- nages : chacun des personnages de la triade arthurienne présente des caractéristiques et joue un rôle dans l’articulation du récit qui se retrouvent peu ou prou chez son homologue dans la mythologie des Nartes ; au triangle Keu-Gauvain-Arthur répond ainsi le triangle Syrdon-Soslan (Sossryko chez les Tcherkesses)-Batradz.
Ingénieusement, Joël-Henri Grisward ne commence pas son analyse par la figure centrale, Arthur ou Batradz, mais par le sénéchal Keu, un personnage peu sympathique, querelleur, mauvaise langue (« cruels de parole et pognans ») et piètre chevalier : vantard, il est systématiquement défait au combat. Cette place au commencement de l’étude se justifie par le rôle que Keu joue souvent dans le récit (et que la tradition des médiévistes a largement méconnu) : celui d’un séparateur et d’uninitiateur du repas ou de l’aventure. Il officie souvent comme éclaireur ou commemessager. Mais en commençant par un personnage, sinon secondaire, du moins assez systématiquement négatif, l’auteur conduit son analyse comme une ascension : l’énigme se noue avant de trouver sa solution ; à la fin, le sommet – le héros central – éclairera le paysage et les multiples chemins qui le traversent. « Keu premier » joue un rôle de « trublion social » qui se retrouve chez son homologue ossète, Syrdon. Ce dernier manifeste, de même que Keu et le dieu scandinave Loki, lui aussi calomniateur, une prodigieuse affinité avec l’eau. Keu est l’exact opposé du « chevalier soleil » Gauvain, avec lequel il forme toutefois un couple indissociable, tout comme Syrdon le fait avec Soslan. La force de Gauvain croît avec la course du soleil et atteint son sommet à midi, heure à laquelle, selon la Mort le roi Artu, il a été baptisé ; christianisation d’un thème mythologique lié au cycle du soleil (coucher ou solstice d’hiver). Solaire aussi la générosité sans limites attribuée à Gauvain. Cette générosité bénéficie en particulier « as damoiselles au besoig » (L’Atre périlleux) : Gauvain est également un grand séducteur. Là encore, c’est un trait ancien. Soslan, homologue ossète de Gauvain, est lui aussi un héros solaire : il demande que sa tombe soit aménagée de manière qu’il puisse apercevoir le soleil à son lever, à son zénith et à son coucher ; il meurt, blessé à la hanche (seule partie de son corps vulnérable) par une roue dévalant une montagne, symbole du soleil descendant du ciel ; comme Gauvain encore, Soslan est un coureur de jupons ; comme lui, il est étroitement lié à son destrier. Soslan est systématiquement opposé à Snyrdon comme Gauvain à Keu : dans chaque cas, les deux personnages sont à la fois antagonistes et inséparables – comme ils le sont du sommet du triangle, Arthur dans le cycle de la Table Ronde et Batradz dans les légendes nartes.
Batradz, fulgurant guerrier, incarnation d’une « mythologie d’orage » (Dumézil), s’identifie à son épée. À sa mort, ses compagnons parviennent, non sans mal, à jeter son épée dans la mer, qui bouillonne et devient couleur de sang. De même, Arthur, mortellement blessé, ordonne qu’on aille jeter Escalibor dans un lac proche : une main sort du lac, brandit plusieurs fois l’épée et disparaît. Entendant le récit, Arthur comprend que sa fin est proche. Dans les deux cas, l’épée joue le rôle de double du héros, elle est son « âme extérieure ». Arthur a entamé sa carrière en arrachant l’épée du rocher ; il la finit en la faisant jeter dans le lac. Il vit et meurt avec elle. Dans la figure d’Arthur, la royauté est seconde : bien des récits attestent qu’il est d’abord – tout comme Batradz qui n’accède jamais à la royauté – un guerrier plein de fureur, exterminateur de géants et de monstres. Sa parenté avec l’orage subsiste dans les grands textes du cycle arthurien, dans Le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes (jetant de l’eau sur une pierre, Arthur déclenche une formidable averse) comme dans La Mort le roi Artu (une pluie « moult grant et moult merveilleuse » tombe quand le roi mourant s’embarque pour l’ile d’Avalon).
Au-delà des traits communs aux personnages respectifs des deux triades et des ressemblances entre leurs aventures, qui ne sauraient être des coïncidences, Joël-Henri Grisward insiste, de façon convaincante, sur les relations qui les unissent et sur l’importance du nombre trois : trois personnages, souvent trois épreuves à affronter, trois qualités qui doivent être celles du parfait chevalier (le courage, la tempérance et la générosité) comme du souverain et qui reflètent l‘idéologie royale des Indo-Européens mise en évidence par Georges Dumézil, elle-même reflet de leur stratification sociale. Même si, avec un immense talent de conteur, Geoffroy de Monmouth a prétendu présenter une Historia regum Brittaniae, il a emprunté à un vieux fond de légendes et de traditions qui se retrouvent dans plusieurs rameaux du folklore indo-européen. Arthur et ses compagnons sont des archétypes ou du moins leurs héritiers. « Au commencement, nous dit Grisward, étaient le conte et les histoires, non l’Histoire ». L’enquête nous donne envie de lire ou de relire ces textes fabuleux, et peut-être de découvrir de nouvelles connexions. L’auteur conclut son enquête par ces mots : « Nous avons ouvert nous aussi la porte d’un jardin. Sans doute d’autres sentiers se dissimulent-ils à notre regard. »
ÉTUDES PROUSTIENNES
Les Éditions Rue d’Ulm (Presses de l’ENS-PSL), en liaison avec l’ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes),
ont livré dans le dernier numéro (53) de 2023 du Bulletin d’ informations proustiennes une superbe moisson de documents sur laquelle nous attirons de nouveau l’attention.
Ce n’est pas sans mérite, tant les découvertes et révélations sur les manuscrits de Proust, leurs brouillons, les lettres perdues dans diverses sources se sont multipliées depuis la fin de l’édition Kolb de 1993. En 2022 et 2023, à l’occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust, qui succédait aux cent cinquante ans de sa naissance (en 1871), une vingtaine de colloques, plusieurs rééditions et publications ont encore enrichi la connaissance du monde proustien. Les six rubriques de ce dernier numéro (Inédits, Genèse, Proust interdit, Formes de l’ écriture, Notes de lecture, Activités proustiennes), qui rendent compte de la plupart de ces manifestations ou documents, sont le fait de chercheurs chevronnés et, on a envie de dire, méritants. Les sujets les plus brûlants (OEdipe, homosexualité, antisémitisme), souvent « cryptés » au fil des réécritures, sont ici décortiqués avec beaucoup de compétence et de subtilité. Dans l’océan récent des diverses publications, ce n’est pas leur moindre intérêt.
Mireille Gérard (1961 L)
MUSICIENS
Notre camarade Bruno Le Maire (1989 l) a publié en 2023 une Fugue américaine mêlant, de façon décalée comme il se doit, réflexions musicales, chroniques politiques en URSS et aux États-Unis, histoires de couples, interroga- tions sur la création artistique. Dans le même temps, Pierre Squara, cardiologue anesthésiste, auteur de plusieurs romans historiques, notamment Hémiole, a fait paraître en 2022 l’histoire d’une jeune fille fictive, Melody, La Violoniste, musicienne accomplie dès l’âge de 8 ans. Bien que Squara ne soit pas normalien, les deux ouvrages méritent un parallèle.
La grande différence est que Bruno Le Maire consacre son développement à un grand pianiste, Vladimir Horowitz, qui, déprimé, a cessé de jouer pendant douze ans, de 1953 à 1965. C’est la même durée que celle du fameux silence de Racine entre Phèdre (1677) et Esther (1689). En revanche, même si les exemples de virtuoses féminines comme Julia Fischer, Camille Bertholet ou l’Américaine Lindsey Sterling ne manquent pas, Melody est un personnage purement romanesque. Elle cesse de jouer parce qu’elle fait une rencontre amoureuse, qui amène son mécène à lui retirer son violon, un Guarnerius. Or le violon était comme le prolongement de son corps ; elle se sent mutilée.
La petite Melody, formée par sa mère et un professeur russe à partir de 8 ans, n’a pas l’audace du pianiste ukrainien de 46 ans. Elle ne critique pas l’auteur, mais marie son nouveau violon, un Guarnerius, à l’inspiration du 24e caprice de Paganini. Cette prise de contact est comme un coup de foudre amoureux. La même extase se reproduit lorsqu’à 16 ans elle joue à Moscou le Concerto de Tchaïkovski : « Pour la première fois, j’oubliai la partition, les notes, les ornements, et je m’évaporai dans l’éther. » Bien plus tard, lorsqu’elle écoute puis joue les concertos de Paganini, elle sait reconnaître les atmosphères : « Je décelais un peu de l’âme russe dans son andantino (p. 219), une magnifique apparence, mais un déchirement pudiquement contenu ». Melody rappelle que Paganini touche l’âme en « s’adressant au corps entier, à la peau, au cœur, aux tripes, aux yeux, au souffle, à l’instinct ».
Autre élément commun aux deux œuvres : la dépression y est très présente, comme l’envers indispensable du génie. Mais il y a des dépressions créatrices, comme celle d’Horowitz, et des dépressions destructrices, comme celle qui mène Franz, le frère malheureux d’Oskar, au suicide. Une sorte de malédiction s’abat sur la famille Wertheimer : Oskar obtient de son frère Frantz qu’il suive une leçon du grand Horowitz, et cette leçon, illustrée par deux sonates de Beethoven, le décourage de continuer à jouer du piano. Les mêmes failles existent chez Horowitz, mais il les surmonte en variant sa musique : après les romantiques allemands, il choisit, pendant son silence de douze ans, de jouer des latins plus lumineux : Clementi, Scarlatti. « Le chant vaut mieux que la technique » dit-il alors. Le pianiste n’en reste pas moins un insoumis : il pose ses mains à plat sur le clavier, et son tabouret est toujours au-dessous de sa position idéale. Désolé de ne pouvoir jouer du piano, Franz se fait agent immo- bilier et se laisse ruiner par une femme amatrice de fourrures et de réceptions.
Les conclusions de ces aventures s’opposent : Oskar n’a utilisé son savoir de grand psychiatre que pour aider Horowitz, et il s’aperçoit trop tard qu’il a laissé périr son frère Franz. La lettre du 20 novembre 1963 de Franz à Oskar est un impitoyable réquisitoire : « Le médecin que tu es sait très bien qu’il aurait pu porter secours à son frère Franz, mais il ne l’a pas fait. » (p. 454) Oskar n’a eu que des relations amoureuses, sans enfants, avec la « politique » Julia. Mais il ne s’est pas engagé en politique. À l’inverse, après un moment d’égarement consacré à la haine, Melody se reprend : elle comprend qu’il n’est pas indigne de jouer de la country avec des voisins sympathiques, et elle réhabilite Paganini, considéré par le public cultivé comme un acrobate, voire un démon, en tout cas un musicien de seconde zone. Le roman se termine par une fête populaire mêlant rythmes de musique country et Paganini devant un public enthousiaste. Quant à la leçon de Fugue américaine, on pourrait la résumer dans la formule suivante : « Wladimir Horowitz comme Sviatoslav Richter, à l’évidence, n’avaient aucune conviction à étouffer, car la réalité politique était accessoire, la seule vérité était dans la musique. » (p. 319)
Jean Hartweg (1966 l)
HELLÈNIKA. 80 VERSIONS GRECQUES COMMENTÉES
L'édition revue et augmentée du recueil de versions grecques publié en 1999 par Guy Lacaze, sous le titre Manuel de version grecque à l’usage des concours, s’inscrit dans une ancienne tradition et la renouvelle. L’entrée en matière est en effet la reproduction de la préface des Commentaires de la langue grecque rédigés dans l’édition de 1548, procurée par l’imprimeur Robert Estienne. Ce texte en grec est adressé à François Ier, dont on sait qu’il a créé en 1530 le Collège des lecteurs royaux, origine de notre Collège de France. Jérémie Pinguet rend un vibrant hommage à son prédécesseur et à « l’élégante exac- titude » de ses traductions. Tous les textes sont traduits et vingt-cinq sont suivis d’un commentaire développé. Jérémie Pinguet s’est contenté de proposer des notes abondantes aux cinquante-cinq versions non commentées. Il a ajouté aux soixante- dix-neuf textes de Guy Lacaze un quatre-vingtième, tiré des Pensées de Marc-Aurèle, associant l’amour du grec et celui de l’humanité.
L’ouvrage est divisé en cinq sections : Orateurs, Historiens, Théâtre, La pensée dans ses États généraux, La chanson du mal-aimé avec, pour finir, une « section spéciale » intitulée Un cursus universitaire. À l’intérieur de chaque section, les textes sont grou- pés par ordre de difficulté croissante : licence-CPGE, Capes, agrégation, et même quelques « top niveau ». Le classement n’est pas facile, de l’aveu même des auteurs. Xénophon, auteur réputé facile, est classé « top niveau » pour un extrait de l’Écono- mique. Thucydide, réputé difficile, a été proposé au concours de l’ENS de Lyon, au Capes et à l’agrégation. La rubrique Méthodologie et conseils, rédigée par Guy Lacaze, insiste sur la traduction des particules, deux fois plus nombreuses en grec qu’en fran- çais, sur la nécessité de connaître les conjugaisons, sur l’indispensable correction de la traduction.
L’essentiel reste la réflexion sur les textes. Guy Lacaze rappelle qu’il faut connaître la civilisation grecque, notamment des pratiques particulières comme le rôle des sycophantes, dénoncés par Démosthène dans son discours Contre Théocrinès : ils ne rendent pas service à la cité, mais s’enrichissent en se faisant payer par ceux-là mêmes qu’ils accusent. L’helléniste confirmé s’en amuse : « Que pourront-ils faire avec ce grisbi ? Belles bagnoles, petites pépées, grande bouffe, les Caraïbes, la finale du Mondial de foot ? » Il n’en reconnaît pas moins que la difficulté du texte risque d’empêcher les candidats de rire. Plus sérieusement, le raisonnement des Athéniens en présence des Spartiates bloqués à Pylos est difficile à comprendre. Après l’évo- cation d’une évasion possible des prisonniers spartiates jusque-là bloqués sur leur île, la capitulation et l’arrestation des Spartiates sont évoquées dans une sorte de proposition indépendante. Cet exemple montre le lien communautaire qui, un séjour commun à l’École aidant, assure la coopération entre hellénistes distingués :
« J’ai soumis la difficulté à mon camarade Patrice Cauderlier, distingué philologue à Dijon et à Ulm ; il m’a fait parvenir une réponse exhaustive, qui est un modèle de pénétration et de rigueur. » (p. 140)
Cette convivialité fondée sur le savoir, on la retrouve dans la présentation de Théétète à Socrate par Théodore de Cyrène : Théétète n’est pas emporté comme tant de ses camarades. « Il se dirige vers l’étude et la recherche d’une allure si égale, si exempte de heurts, si efficace, jointe à tant de douceur, comme l’écoulement de l’huile qui se fait sans bruit ». Peu s’en faut que Guy Lacaze ne voie en lui le candidat idéal à l’agrégation de lettres ou de philosophie. Cette admiration antique rejoint la reconnaissance à l’égard d’un jury éclairé, composé de Christine Mauduit, direc- trice du département des Sciences de l’Antiquité, et Charles de Lamberterie, tous deux solidaires de l’entreprise du recueil de versions. On voit que le souci technique n’efface pas la préoccupation culturelle.
J. H.
MARC-AURÈLE : ÉCRITS POUR SOI-MÊME ET LETTRES À FRONTON
Professeur honoraire à l’Université de Nantes, Robert Muller vient de publier avec son collègue Angelo Giavatto une nouvelle édition des Pensées de l’empereur Marc-Aurèle, plus justement intitulée Écrits pour soi-même. L’empereur note en effet ses pensées à mesure qu’elles lui viennent, sans souci de publication. Le texte est rédigé dans la langue culturelle de l’aristocratie à l’époque, le grec, Marc-Aurèle a commencé à l’apprendre avec sa mère Lucilla, fondatrice d’un centre de culture hellénique près de chez elle. Les Lettres à Fronton (seule édition disponible actuellement) sont rédigées en latin : Fronton savait le grec, mais, Africain d’origine, il pratiquait l’éloquence latine et conseillait à son élève la lecture de Cicéron.
Les Pensées et les Lettres à Fronton ne sont pas de la même époque. C’est un Marc- Aurèle jeune qui écrit à son vieux maître Fronton, né en 95 alors que Marc-Aurèle est de 121. Fronton meurt en 167, six ans après l’accession de Marc-Aurèle à l’em- pire. Leur affection est forte, mais le rhéteur Fronton n’apprécie guère la conversion de son élève à la philosophie stoïcienne. Il en résulte que la correspondance parle plus de questions de famille et de santé que de stoïcisme. En revanche, les Pensées sont une œuvre tardive, datée par moments par les circonstances historiques : la première lettre mentionne les Quades, que Marc-Aurèle a combattus en Moldavie ; la troisième est écrite à Carnuntum, quartier général de Marc-Aurèle en Pannonie, entre Vienne et Bratislava, de 171 à 173.
Avec Auguste, Marc-Aurèle est sans doute le plus connu des empereurs romains, pour deux raisons : ses Pensées ont été un livre de chevet pour nombre d’humanistes, à partir de leur publication à Cambridge par Thomas Gataker en 1652. Marc-Aurèle passe pour un souverain philosophe, selon l’idéal platonicien. Il a eu le tort d’installer sur le trône son fils Commode, au lieu d’adopter un Romain de valeur, comme il avait lui-même été adopté par Antonin. On le considère donc, à cette erreur près, comme un modèle.
La pratique de la digression n’empêche pas le philosophe de mettre l’accent sur des thèmes stoïciens : l’homme est issu du souffle qui anime l’Univers. Ce souffle se manifeste à quatre niveaux : le premier (hexis) est ce qui assure la cohésion des miné- raux ; le deuxième (physis) permet la croissance des végétaux ; le troisième (psychè) donne vie et mouvement aux animaux ; le quatrième (psychè logikè) permet aux hommes de communiquer par le langage. L’homme intègre ces quatre fonctions et se rapproche des dieux par l’exercice du quatrième niveau. Le monde est ainsi « cité commune des dieux et des hommes » car les uns comme les autres conçoivent le règne des fins, au lieu de se contenter des moyens.
Marc-Aurèle nous sait limités et la mort est souvent évoquée dans son texte. Tout petits dans le temps et l’espace, nous pouvons participer à l’harmonie universelle, écarter les impressions fausses, faire preuve de bienveillance, même à l’égard de ceux qui nous veulent du mal. On peut à ce propos citer l’attitude généreuse de Marc-Aurèle à l’égard du général rebelle Avidius Cassius, qui s’était proclamé empereur en Orient, avant d’être tué par ses officiers. À la conception épicurienne d’un monde régi par les chocs aléatoires des atomes, le philosophe stoïcien préfère l’idée de fonctions hiérarchisées, dont le règne animal donne l’image.
On voit ainsi se dessiner deux figures contradictoires : un homme d’État vain- queur des rebelles germains ou des traîtres comme Avidius Cassius, solidement installé sur un cheval vigoureux, et un philosophe malade, fragile, qui estime devoir se priver des plaisirs de la vie pour accomplir pleinement son rôle. Dans le douzième et dernier livre d’Écrits pour soi-même, Marc-Aurèle rappelle que philosopher, c’est apprendre à mourir : « O homme ! Tu as été citoyen de cette grande cité : que t’im- porte que cela ait duré cinq ou cent ans ? Ce qui est conforme aux lois est en effet égal pour tous. »
J. H.
POUR AXEL
L'ouvrage publié par Jérémie Pinguet et Raphaël Lucchini vise à réparer une injustice : après des débuts brillants, marqués par la fascination de la Roumanie, à laquelle elle consacre deux poèmes dès l’âge de 18 ans, Marie semble s’en- fermer dans un mariage obscur avec un employé de mairie, Antoine Mercier, dont elle a en 1881 un fils, d’abord élevé par le père, et qui deviendra photographe d’art. Les auteurs regrettent qu’on n’ait trouvé aucun portrait photographique de sa mère. En 1891, Antoine Mercier meurt et l’enfant, âgé de 10 ans, retourne vivre avec sa mère, qui habitait chez ses parents. Marie Nizet-Mercier n’a pas renoncé à la littérature : après le Capitaine Vampire, publié en 1879 et proche du Dracula de Bram Stoker, elle publie anonymement à Bruxelles Le Scopit. Histoire d’un eunuque européen. Mœurs russo-bulgares. À cette inspiration orientale succèdent sept nouvelles inspirées par la vie en Flandre et en Wallonie, publiées entre 1883 et 1886 dans la Revue de Belgique. Ensuite, Marie Nizet ne publie plus rien entre 1887 et 1920. Mais l’évènement décisif est la rencontre, à une date qui reste imprécise mais que l’on peut situer en 1908, avec un capitaine malais dont le père était hollandais et la mère anglaise : Cecil-Axel Veneglia. Cet officier de marine ressemble au peintre flamand Anton Van Dick. Toute une mythologie repose sur cette ressemblance. Le premier poème de Pour Axel s’intitule Sosie et se termine par ces vers : « Si je vous confonds un moment/ En une illusion suprême, / Je ne sais plus exactement/ Si c’est vous – ou Van Dick – que j’aime. »
Le poème XXII, Une histoire, mentionne le séjour du jeune Van Dick, aupara- vant élève de Rubens à Anvers, dans la cité flamande de Saventhem, aujourd’hui Zaventhem, où il est aimé d’Isabelle, fille du « mayeur » (premier magistrat municipal). Le jeune peintre l’oublie mais Isabelle ne se marie pas et garde le souvenir de Van Dick jusqu’à sa mort à 98 ans. Elle prie pour lui devant sa toile La Charité de Saint-Martin en l’église Saint-Martin de Zaventhem. C’est l’occasion d’une fusion entre l’histoire du xvie siècle et l’aventure du xixe siècle. Le poème se termine en effet par un dialogue entre Marie et Axel : « Et j’aime imaginer qu’à l’approche du soir/ Le spectre de Van Dick, drapé du manteau noir,/ Pour elle revenait sous les voûtes désertes…/ Ne le croyez-vous pas aussi, mon amour ? — Certes ! » Une cassure apparaît à la fois dans le texte et dans la vie de Marie : en 1914, Axel ne revient pas en Europe. Dans le texte, ce sont des points de suspension, analogues à ceux que Victor Hugo avait placés à la date du 4 septembre 1843, mort de Léopoldine noyée dans la Seine comme le rappelle le livre Pauca meae des Contemplations. Marie use du même procédé à la fin du poème L’Insulinde, nom autrefois donné à la Malaisie, terre où naquit Axel : « Et comme un instinct me l’avait prédit,/ Pavillon en deuil, d’une île lointaine/ Il est revenu, le bateau maudit/ Il est revenu… sans le Capitaine ! »
Placé sous le signe des quatre saisons, du printemps à l’hiver, le premier mouve- ment du texte se superpose à l’image du beau capitaine : le jardin plein de roses,« c’est le jardin d’Axel » et l’hémistiche ouvre et ferme le poème. Chaque saison résume Axel : « j’ai vu rire/ Dans vos yeux clairs, le rire immense de l’été ». Axel couvre à ce point le monde que toute jalousie devient impossible. Melati a été sa maîtresse, mais peu importe, car tout revient, en une boucle lyrique, à Marie : « Mais tu restes mon ombre, et tu n’es que le verre/ Où, s’il a soif, il boit l’amour en mon honneur ».
La présentation de ce recueil mérite une remarque : l’appareil critique est de niveau universitaire, notamment sur l’établissement du texte. Un appendice érudit confronte les cinq textes imprimés en 1923 et les deux manuscrits autographes. En même temps, les notes expliquent des mots simples comme « roturier » ou « liseron ». La réponse est sans doute dans le désir de faire connaître cette écriture minoritaire (on est en Belgique) et féminine au plus grand nombre. Le travail de Raphaël Lucchini et Jérémie Pinguet fait revivre le texte.
J. H.
UNE PHILOSOPHIE DU VIN
Une philosophie et non « la philosophie » : professeur de philosophie émérite à l’Université de Paris 1, Pierre-Yves Quiviger tient à laisser à son étude l’allure du roman, ou même du menu. Entre les chapitres 4 et 5 se développe un texte intitulé « Trou normand » et qui évoque l’expérience de la vodka russe à Moscou. Le livre n’atteindra pas le chapitre 8 : « le vin des philosophes » occupe donc le chapitre sept et demi, suivi tout de même par « une dernière petite goutte ». Le jeu continue dans la bibliographie, qui débute par une « littérature primaire » composée par les adresses de domaines viticoles. Les uns sont prestigieux, comme Petrus à Pomerol ou le Château d’Yquem à Sauternes, ou encore Montrachet à Meursault, d’autres jouent un rôle de repoussoir, comme La Payse, située à Chantovent, rue du Port-au-Vin, BP 7, à Bonnières-sur-Seine.
C’est que l’auteur veut non pas dresser un dictionnaire des grands crus, mais faire part d’une expérience directe du vin. Philosophe, il s’attache forcément à la perception du réel : faut-il goûter « à l’aveugle », sans savoir ce que l’on goûte, ou être instruit de la nature du vin que l’on goûte ? La dégustation à l’aveugle a le mérite de la fraîcheur et de la pureté ; mais elle perd « en profondeur et en finesse ». Mieux vaut donc savoir ce que l’on goûte. Cette dégustation « informée » développe une culture fondée sur la curiosité : on peut ainsi comparer des pinots gris alsaciens venant de terroirs argilo-limoneux, sableux-calcaire, volcano-sédimentaires. Dans ce cas, plutôt que de plaisir fugitif, il faut parler de joie, car la comparaison enrichit la perception.
Qu’est-ce qu’un bon vin ? Pour répondre à cette question centrale, l’analyse associe d’abord le vin qui accompagne un repas : le caviste recommande un vin de Savoie pour déguster une raclette. L’origine (Thonon-les-Bains), le nom (cru Ripaille) et le cépage (chasselas) font rêver. Bouteille et plat sont savoyards tous deux. L’acidité du vin « mangera » le gras du fromage. L’ensemble est donc harmonieux. Tout en recon- naissant l’expérience des connaisseurs, Pierre-Yves Quiviger se réclame de Kent Bach, qui privilégie le plaisir : « Avec le vin, le plaisir de sentir et de goûter vient en premier. »
Boire du vin est d’abord une pratique sociale. Mais on peut distinguer quelques catégories de buveurs solitaires : les professionnels du vin, les alcooliques et les « routi- niers » qui ont toujours bu le même vin et les mêmes quantités. Dans L’Expérience sociale du vin, Pierre-Yves Quiviger énumère des connaisseurs qui savent goûter, mais aussi écrire. Il faut des qualités d’écriture pour célébrer un vin exceptionnel. À la faveur de la griserie qu’il engendre, le vin « fait parler ». Il fait aussi écrire. Le chapitre consacré au Vin des philosophes évoque La Nouvelle Héloïse, où Julie dissuade Saint- Preux d’arrêter tout à fait de boire du vin, et les Propos des Bien-Ivres au chapitre 5 du Gargantua posent une équivalence entre ivresse et éternité : « Je bois éternellement, c’est une éternité de beuverie, et une beuverie d’éternité ».
J. H.
LES ÉDITIONS RUE D’ULM
Vous coûtez trop cher !
Depuis vingt-cinq ans, les éditions Rue d’Ulm, comme beaucoup d’autres presses d’éta- blissements d’enseignement et de recherche, s’autofinancent au moyen de leurs recettes directes (ventes d’ouvrages après déduction des marges diffuseurs-distributeurs et libraires, cessions de droits et droits de copie, aides à la publication...) tout en étant soutenues par l’École (salaires pris en charge de ± 4 personnels et mise à disposition de locaux), ce qui leur permet d’assumer leurs dépenses (autorisations de reproduction, maquettes, mise en page et numérisation extérieures, impression et fabrication, droits d’auteur et de traducteur, assurance, publicité, courrier et téléphone, équipement, documentation et fournitures...). C’est ce qu’on appelle dans la profession le « petit équilibre », qui, si petit qu’il soit, est parfois assez acrobatique. Coûtons-nous trop cher, rapporté au travail effectué et aux livres publiés ? La question se pose à chaque nouvelle direction – surtout quand elle est direc- tement concernée par le livre, sinon parfaitement informée. Les archicubes et les amis de l’École comptant parmi nos lecteurs fidèles, ce serait aussi à eux d’en juger année 2024 s’est ouverte par la publication, dans la collection « Versions fran- çaises », d’un roman inédit, ou plutôt d’une autobiographie, ce qui n’est pas tout à fait la même chose, nous rappellerait Philippe Lejeune. Dans la banlieue verte de Berlin, au cours des années 1930, un garçon rêveur grandit, perdu dans ses livres. Le royaume de son imagination n’a que peu à voir avec l’environnement immédiat ou avec le régime qui se met en place. Pendant que les haut-parleurs exaltent autour de lui la force virile, l’adolescent s’éveille à l’amour et n’écoute que sa fantaisie… Puis on lui colle sur la tête un casque de soldat. Il a 17 ans. Quatre décennies plus tard, un écrivain repart sur les traces de ses vingt premières années. Il s’en est fallu de peu que l’Allemagne nationale-socialiste, en s’écroulant, n’écrase son propre corps sous les décombres. C’est un survivant qui témoigne. Non sans une ironie très maîtrisée et dans un style dépouillé qui n’est pas sans évoquer la fameuse écriture blanche.
À quoi servent les ornements en art ? La dispute de l’ornement que nous ont rendue familière les travaux de l’historien de l’art Aloïs Riegl et le célèbre pamphlet d’Adolf Loos (Ornement et crime, 1908), tout comme les prises de positions des artistes du modernisme et du minimal art, s’inscrit dans une histoire longue. Les Concepts préliminaires à une théorie des ornements de Karl Philip Moritz, publiés en 1793, en constituent une étape décisive. Auteur incontournable des Lumières allemandes, Moritz choisit l’enquête empirique et la description pour construire une théorie des ornements grâce à l’étude des motifs et la connaissance des productions qu’un long voyage en Italie et l’observation des demeures berlinoises lui ont procurées. Il fait des ornements une pièce indispensable de l’esthétique telle qu’elle se conçoit à la fin du xviiie siècle. À l’opposé de l’allégorie, les ornements sont des formes libres qui n’imitent rien, qui n’ont pas de signification. Ils renvoient, dans le cadre d’une définition du beau, à la dimen- sion anthropologique du besoin d’art et contribuent à la promotion de l’imagination. Conçu dans le contexte de l’Académie des arts de Berlin, ce texte a un rôle éducatif ; il remplit aussi une fonction politique, à l’heure d’une industrialisation croissante des arts appliqués autour de 1800. Nous en avions publié une première édition française il y a quinze ans dans la collection « Æsthetica » de Danièle Cohn, auteure d’une préface importante pour cette nouvelle édition en « Versions françaises », intégralement revue, augmentée de 50 illustrations et mise à jour du point de vue scientifique et bibliographique par la traductrice, Clara Pacquet, spécialiste de K. Ph. Moritz, qui enseigne l’histoire et la théorie de l’art à l’École supérieure d’art Pays basque. [Sur l’ornement – 22 € – 14 × 18 cm – 280 pages]
Nous rendrons compte ensuite de quatre livres de sciences sociales et philo- sophie des sciences, respectivement parus dans les collections « Rue d’Ulm/ Essai », « Sciences durables », « Sciences sociales » et « Les rencontres de Normale sup’ ».
L’encyclopédie libre Wikipédia a révolutionné à bas bruit l’accès à l’information pour des milliards d’individus sur la planète. Mais qui sait comment elle fonctionne ? qui édite le site ? et selon quels principes ? Quand – et pourquoi – peut-on avoir confiance dans les informations qu’elle fournit ? Au-delà, de quoi l’encyclopédie que « tout le monde peut éditer » est- elle réellement le nom ? Car Wikipédia ne représente qu’une déclinaison particulière d’un modèle d’organisation né avec Internet : la « production participative ». Jérôme Hergueux (CNRS, affilié au Center for Law and Economics de l’ETH Zurich et associé au Berkman Klein Center for Internet & Society de Harvard) invite le lecteur à décou- vrir ce nouveau modèle, horizontal et non marchand. Il retrace l’histoire de son émergence à partir de celle de ses acteurs, décrit la manière singulière dont Wikipédia est née et examine les raisons de son succès. Il interroge les défis contemporains qu’elle doit affronter : biais de genre, de race et de classe sociale, problèmes d’inclu- sion ou de capture politique… À l’heure de la manipulation de masse sur Internet, des réseaux sociaux alimentant haine d’autrui et polarisation politique, que nous dit le « modèle Wikipédia » de l’avenir de nos pratiques pédagogiques, de l’éducation citoyenne à l’esprit critique, de notre écosystème médiatique et informationnel, du rôle stratégique de l’État et du fonctionnement de nos institutions démocratiques ? [Wikipédia, ou Imaginez un monde – 15 € – 15 × 21 cm – 160 pages]
Déclenchée par une hausse du prix du carburant, la révolte des Gilets jaunes est rapidement devenue un vaste mouvement d’opposition radicale à l’État, nourri de nombreuses revendi- cations contre les injustices sociales et économiques. Dès le 17 novembre 2018, elle se fait connaître par des moyens d’action inhabituels : occupation de milliers de ronds-points, construc- tion de cabanes, manifestations-émeutes sans drapeaux ni cortèges. Pour dépasser l’étonnement face à un mouvement inclassable, ce livre collectif de 21 contributeurs propose, à partir d’études de cas concrets, une analyse critique de ses ambivalences, qui ont tantôt limité, tantôt amplifié l’insurrection. Aux ambivalences vis-à-vis des syndicats répondent les liens versatiles avec l’extrême droite organisée. Aux réactions contradic- toires de la sphère médiatique répondent des appropriations politiques et une répression policière et judiciaire exceptionnelles. Les auteurs donnent ainsi à comprendre de façon limpide les formes contemporaines de la contestation, sous la direction de Quentin Ravelli (CNRS-Centre Maurice Halbwachs), Johanna Siméant-Germanos (directrice du département de Sciences sociales ENS-PSL, Médaille d’argent du CNRS), Pauline Liochon (IRISSO-Paris Dauphine) et Loïc Bonin (Interlogement 93). [Les Gilets jaunes. Une révolte inclassable – 22 € – 15 × 21 cm – 432 pages]
En 1943, au terme d’études de médecine entamées en 1936, l’agrégé de philo- sophie Georges Canguilhem (1904-1995) soutient une thèse de doctorat en médecine intitulée Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Éclairant de manière magistrale l’histoire du concept de norme, distinguant anomalie et anormalité dans le fonctionnement organique, soutenant que la « maladie » doit être rapportée à la mesure du sujet individuel que constitue le patient évaluant son propre état, cette thèse demeure le plus célèbre de ses ouvrages. Mais qui a contribué à cette célébrité ? Quelle est l’histoire de la réception de l’Essai ? Qu’est-ce qui en a fait une référence majeure, y compris dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychanalyse ? Et, plus de quatre-vingts ans après, quelles hypothèses et quels concepts de ce livre décisif ont gardé toute leur pertinence sur le plan philosophique, biologique ou médical ? Sous la direction de Pierre F. Daled (Université libre de Bruxelles), Mathias Girel (B/L 1993, directeur du Caphés, CNRS-ENS) et Nathalie Queyroux (responsable du Centre documentaire du Caphés), ce livre s’efforce de répondre précisément à ces interrogations. [Georges Canguilhem, 80 ans après Le Normal et le Pathologique – 16 € – 15 × 21 cm – 216 pages.Dans la série des « Actes de la recherche à l’ENS », nativement numérique avec impressions à la demande, est disponible en ligne un volume spécialement précieux pour les agrégatifs d’anglais des sessions 2024 et 2025. Américain puis britannique, protestant puis anglican, moderniste puis classique, T. S. Eliot parcourt au fil de sa vie plusieurs trajectoires de transition, voire de conversion, qui font de lui un poète pivot, représentant d’un cosmopoli- tisme masculin et blanc qui a très fortement façonné le canon poétique anglo-saxon du xxe siècle. Il produit une critique subversive de la civilisation et de la modernité telles qu’elles se manifestent dans les premières années du siècle, déplorant une décadence sociale et morale généralisée, précipitée, selon lui, par l’ère industrielle, la guerre et leurs innovations technologiques mortelles et amorales. L’utilisation elliptique et souvent cryptique des citations et de l’intertextualité, défiant les limites du langage, l’ironie corrosive de ses observations des mœurs contemporaines et la quête incessante d’une transcendance individuelle et collective, la mise en ques- tion de l’expression poétique même – telles sont les armes d’un combat poétique titanesque. Seul remède à cette condition humaine dégradée, la redéfinition du génie poétique, attribut d’un nombre réduit d’élus, ouvrirait la voie hypothé- tique d’une rédemption finale. [T. S Eliot agoniste – textes édités par Hélène Aji (A/L 1990, département Littératures de l’ENS-PSL), Agnès Derail et Clément Oudart (Sorbonne Université) – 12 € – 15 × 21 cm – 180 pages]